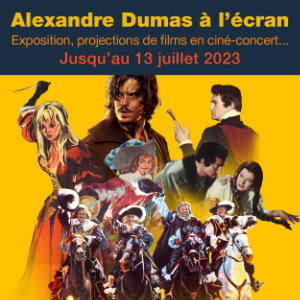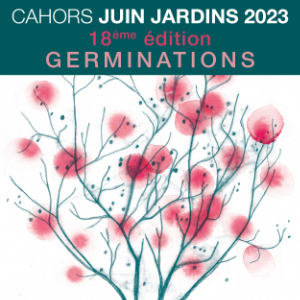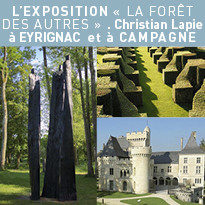Une exposition originale consacrée à Rembrandt et son héritage.
 Jean-Baptiste Santerre, La Coupeuse de chou, huile sur toile, Bordeaux, musée des Beaux-Arts
Jean-Baptiste Santerre, La Coupeuse de chou, huile sur toile, Bordeaux, musée des Beaux-Arts
Du 15 novembre 2025 au 14 mars 2026, le Musée des Beaux-Arts de Draguignan présente l’exposition “Le Phare Rembrandt”
À travers une sélection de cinquante peintures visibles à l’époque, dont certaines de Rembrandt, d’autres lui ayant été attribuées, et d’autres encore ayant été réalisées par des artistes ayant étudié ou collectionné son travail, l’exposition explore les thèmes de l’imitation et de l’appropriation de son art.
Le parcours met en lumière les diverses qualités qui ont progressivement été associées à son nom, à sa gestuelle et à son style, de la fascination des collectionneurs pour ses portraits saisissants à son traitement magistral du clair-obscur.

Autoportrait aux deux cercles
Peinture de Rembrandt, 1665, Kenwood House de Londres
Le phare Rembrandt
Une exposition d’intérêt national au musée des Beaux-Arts de Draguignan
Le musée des Beaux Arts de Draguignan présente, du 15 novembre 2025 au 15 mars 2026, l’exposition Le phare Rembrandt consacrée à la réception de la peinture de Rembrandt (1606-1669) auprès des peintres et amateurs français du siècle des Lumières.
Cette exposition originale, labellisée d’intérêt national par le ministère de la Culture, se concentre sur la réputation de Rembrandt et sa gestuelle picturale.
En réunissant une sélection d’une cinquantaine d’oeuvres visibles en France au XVIIIe siècle qui lui étaient alors attribuées et celles de peintres l’ayant regardé,
voire collectionné, elle vise à rendre sensible la question de l’imitation et de l’appropriation d’une matière qui fascinait à la fois les artistes et les collectionneurs, bien avant que le romantisme ne fige l’image d’un génie malheureux et isolé.
 École française du premier quart du XVIIIe siècle d’après Alexis Grimou,
École française du premier quart du XVIIIe siècle d’après Alexis Grimou,
L’Enfant à la bulle de savon, huile sur toile, Draguignan, musée des Beaux-Arts
Les “Rembrandt” de Draguignan
Le musée des Beaux-Arts de Draguignan conserve dans son fonds ancien deux figures de fantaisie, entrées toutes deux dans les collections dès 1793 du fait des saisies révolutionnaires, sous le nom de Rembrandt.
De même format, elles représentent chacune un jeune homme coiffé d’une toque portant une chaîne en or, dans une palette réduite, avec de forts effets de clair-obscur. Les deux tableaux proviennent de la même collection dans laquelle ils formaient sans doute, au XVIIIe siècle, une fausse paire permettant d’apprécier, à partir d’une idée commune de la peinture de Rembrandt, deux interprétations stylistiquement très différentes.
En 1999, un jeune homme vola l’un des deux “Rembrandt” du musée, L’enfant à la bulle de savon, après avoir été médusé par le tableau. L’œuvre fut retrouvée quinze ans plus tard. Les historiens de l’art qui la découvrirent à cette occasion refusèrent unanimement son attribution à Rembrandt, malgré une jolie fausse signature, et la réattribuèrent à un habile pasticheur français du XVIIIe siècle.
 École hollandaise du XVIIe siècle, Portrait de jeune homme portant une toque rouge et une chaîne d’or,
École hollandaise du XVIIe siècle, Portrait de jeune homme portant une toque rouge et une chaîne d’or,
huile sur toile, Draguignan, musée des Beaux-Arts
Le deuxième tableau, Portrait de jeune homme portant une toque rouge et une chaine d’or, qui avait également été attribué à Rembrandt, a été peint par un artiste, sans doute hollandais, du XVIIe siècle.
Autrement dit, un collectionneur varois avait réuni au XVIIIe siècle dans son cabinet deux peintures rembranesques de deux mains et deux époques différentes, qui évoquaient toutes deux directement le maître d’Amsterdam par leur sujet, leur palette et leur facture, sans qu’aucune des deux ne sorte de son atelier.
Cette redécouverte est à l’origine de l’exposition Le phare Rembrandt, dont l’ambition est de mieux faire connaître le goût pour la peinture de Rembrandt dans la France des Lumières, au moment où ses peintures commencent, quarante ans après sa mort, à quitter la Hollande et à gagner les cabinets des amateurs français. Paris devient à la même période la capitale du marché de l’art européen.
Comme le montrent les œuvres du musée de Draguignan, les modèles de Rembrandt (ou considérés alors comme peints par lui) fascinèrent les amateurs mais également les artistes, troublés par l’audace technique du maître et sa merveilleuse intelligence de la lumière.

Jean Honoré Fragonard, La Famille heureuse, 1775,
huile sur toile, Washington, The National Gallery of Art
Histoire du goût, histoire d’œils
L’accrochage des œuvres tout au long du parcours, le parti-pris scénographique et les dispositifs de médiation conçus pour l’exposition visent à immerger le visiteur dans une période au cours de laquelle les Français apprirent à connaître, apprécier et décrire les peintures de Rembrandt, de plus en plus nombreuses sur le marché.
Articulé en trois chapitres, le parcours met l’accent sur les qualités appréciées dans la gestuelle de Rembrandt (mais aussi ses défauts) et l’originalité de sujets tels que les tronie qui contribuèrent à la naissance et au développement en France du genre de la figure de fantaisie.
En confrontant des tableaux du XVIIe siècle et leurs descendants français, l’exposition a pour ambition de sensibiliser le visiteur à des problématiques à la fois commerciales (attributions, circulation des œuvres…), plastiques (accord et juxtaposition des couleurs, distance nécessaire face au tableau, circulation de la lumière…) ou esthétiques (construction d’un lexique nécessaire pour décrire les artifices de la “magie” des œuvres de Rembrandt…). Ces problématiques sont approfondies dans des focus qui scandent le parcours.
Enfin, différentes expressions issues de la littérature artistique du XVIIIe siècle ponctuent avec poésie les cabinets qui se succèdent dans une atmosphère faisant allusion aux cabinets des collectionneurs.
Une ambition scientifique universelle
De nombreux dispositifs de médiation seront proposés dans l’exposition. Cette approche ludique et accessible vise à permettre à tous les publics, y compris ceux les plus éloignés, de se prêter à l’exercice d’apprentissage du regard auquel les Français des Lumières se sont confrontés face aux peintures de Rembrandt. Ils pourront ainsi s’initier à la reconnaissance des accessoires, à la lecture des compositions, à l’analyse de la gestuelle du peintre et à la construction d’un vocabulaire artistique.
L’exposition est accompagnée de la publication d’un catalogue richement illustré, publié par les éditions In Fine. Celui-ci réunit des essais d’historiens de l’art français, américains et néerlandais, ainsi que des notices des œuvres présentées. L’ouvrage offre ainsi une plongée dans les sources du XVIIIe siècle, telles que les guides, catalogues de ventes et biographies d’artistes, pour comprendre la manière dont les œuvres de Rembrandt étaient perçues et ce que son nom signifiait pour les artistes et les amateurs.
 Rembrandt van Rijn, La Sainte Famille avec Sainte Anne mère de la Vierge, 1640,
Rembrandt van Rijn, La Sainte Famille avec Sainte Anne mère de la Vierge, 1640,
huile sur bois, Paris, musée du Louvre
Rembrandt, Chardin, Fragonard…
De nombreux prêteurs français et étrangers, musées et collectionneurs, contribuent à l’exposition. Le musée du Louvre prête ainsi l’un des Rembrandt les plus précieux des cabinets parisiens du XVIIIe siècle, La Sainte Famille avec Sainte Anne, chéri par la comtesse de Verrue avant de passer dans les cabinets Voyer, Gaignat et Praslin, acquis pour le Muséum au prix colossal de 17120 livres en 1793. Très copié et admiré, le tableau sera mis en regard d’œuvres de Fragonard, Coypel et d’un pastiche peint par Oudry en 1753, La lice et ses petits (musée de la Chasse et de la Nature), qui retint de Rembrandt le délicat clair-obscur transposé dans une délicieuse scène de famille… de chiens.
 Atelier de Rembrandt van Rijn (Ferdinand Bol ?), Portrait d’homme en costume oriental, 1641 ?,
Atelier de Rembrandt van Rijn (Ferdinand Bol ?), Portrait d’homme en costume oriental, 1641 ?,
huile sur bois, New York, The Leiden Collection
Quatre peintures de la National Gallery of Art de Washington traversent l’Atlantique dont trois de Rembrandt et son atelier, parmi lesquelles l’exceptionnelle Balayeuse qui fit partie de la collection Crozat cédée à Catherine II en 1772 et qui fut copiée par Fragonard, avant de partir en Russie. Le peintre de Grasse fut l’un des artistes qui comprit le mieux la poésie mais aussi la force d’expression de Rembrandt. Huit de ses peintures sont présentées parmi lesquelles les trois chefs-d’œuvre du musée d’Amiens, dont la Tête de vieillard retrouvera celle du musée de Nice, accrochées à proximité de deux possibles modèles de l’atelier de Rembrandt.

Alexis Grimou, Jeune homme en cuirasse, vers 1730,
huile sur toile, Montpellier-Agglomération, musée Fabre
Le visiteur pourra également apprécier la confrontation des figures de fantaisie de Grimou, qui fut sans doute le plus explicitement rembranesque des “Rembrandt français”, et des précédents hollandais parmi lesquels le Portrait d’Amalia von Solms de Rembrandt prêté par le musée Jacquemart- André. Santerre, Chardin, Greuze, Rigaud, De Troy viendront eux aussi enrichir le parcours d’œuvres témoignant, avec une étonnante diversité, de la postérité française de l’œuvre de Rembrandt au siècle des Lumières.

Hyacinthe Rigaud, Autoportrait, vers 1698, huile sur toile, collection particulier.
Informations pratiques
Musée des Beaux-Arts
9 rue de la République
83300 Draguignan
www.mba-draguignan.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi.
Gratuit le 1er dimanche du mois.
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.